Lundi 19 septembre, 7 heures du matin. La petite foule des
demandeurs d’asile s’agite sur le trottoir étroit de la rue Ernest Renan, une
voie discrète, bordée de pavillons et d’entreprises, du quartier du Chemin de l’Île,
à Nanterre. C’est là que la FACEM, entreprise privée chargée du pré-accueil des
demandeurs d’asile par la Préfecture des Hauts-de-Seine, a déplacé ses bureaux,
qui ouvrent à 9 heures, trois jours par semaine. Mais c’est le lundi matin qu’il
faut être là, à attendre des heures avant le jour, parce que la Préfecture ne
traite que 75 ou 80 dossiers par semaine : donc seuls les premiers auront la
chance de pouvoir dans les jours suivants atteindre le guichet du service des
étrangers de la préfecture, chargé de trier et de transmettre les dossiers à l’OFPRA.
Les autres devront revenir la semaine suivante. Avoir les bons numéros, c’est
aussi pouvoir accéder aux droits les plus élémentaires, à un revenu de survie,
à l’accès aux soins, à un hébergement… Pas étonnant dans ces conditions que
quelques jeunes poussent pour resquiller des places, que des querelles éclatent.
Cette fois, une patrouille de police intervient, puis repart après un contrôle
rapide de deux ou trois personnes, qui retournent attendre à leur place avec un
peu moins de nervosité. Mais c’est la
dignité de la très grande majorité qui impressionne. Quand vers 8h30, un
salarié de la FACEM arborera un brassard « sécurité », le calme sera
déjà revenu depuis longtemps dans la file qui s’allonge encore de quelques « retardataires ».
Pour ces hommes, majoritairement jeunes, ces quelques
femmes, venus de pays ravagés par les guerres, les dictatures, les terrorismes et la misère, la souffrance ne s’arrête pas en passant enfin les frontières de l’Europe
forteresse après avoir côtoyé la mort, échappé aux violences de toutes sortes : la
maltraitance continue sur le sol de France. On le voit et le dénonce à Calais,
Vintimille ou Paris, on ne sait pas assez comment ça se passe pour déposer une
demande d’asile auprès des préfectures de banlieues. Et à Nanterre, ce n’est
pas le pire, dit-on.
« Ce matin, pour l’instant, ils ne sont
que 93, et seulement une quarantaine à avoir passé la nuit ici, depuis la
soirée de dimanche », estime Jean-Yves, qui, avec le Secours catholique, organise
chaque semaine un contact humain, distribuant boissons chaudes et
viennoiseries. Certaines semaines, ils sont deux fois plus nombreux. Pas de
sanitaires ni d’abri, alors évidemment des riverains se plaignent. L’affichette
collée sur la vitre du bureau a l’air d’une mauvaise plaisanterie.
La situation est encore pire que devant le 177 avenue
Georges Clémenceau, d’où la FACEM a dû déménager suite aux plaintes de patrons
d’entreprises établies dans les beaux immeubles bordant la nationale 13. Ici,
la misère, à laquelle sont contraintes des personnes qui sont souvent
étudiantes, ingénieurs, professeurs, avocat ou médecins, plus souvent que
cultivateurs ou pêcheurs, est moins visible.
Avoir enfin le numéro permettant d’atteindre le guichet de
la Préfecture ne signifie pas la fin du calvaire. Ceux qui ont eu le malheur de
se faire prendre les empreintes digitales en Italie ou dans un autre pays de l’espace
Schengen, risquent d’y être reconduits, ou au mieux ils devront attendre plus
de six mois pour déposer leur demande d’asile. C’est le cas notamment de
nombreux Soudanais que la police a amené de leur campement parisien au Centre d’Accueil
et de Soins Hospitaliers de Nanterre. Il faudra de toute façon attendre ensuite
plusieurs mois, sinon parfois des années, la décision de l’OFPRA, puis, si elle est négative, le verdict
des magistrats de la CDA. La nouvelle loi qui se présente comme voulant accélérer
les procédures, risque d’entraîner davantage d’arbitraire. Ainsi, il aura fallu
à peine un an pour qu’une jeune femme congolaise, dont l’enfant est scolarisé à
Nanterre, soit déboutée de sa demande, et mise en demeure de quitter le CADA
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile). Le 115 est débordé, de telles
demandes d’hébergement d’urgence sont rarement vite et bien satisfaites. La
majorité des demandeurs d’asile deviennent des sans-papiers. Des circulaires enjoignent les préfectures à
prendre le plus vite possible des décrets d’Obligation à Quitter le Territoire
Français à leur encontre. Pour aller où ?
Associations, organisations syndicales ou politiques,
collectifs citoyens qui luttent pour les droits de la personne humaine, ont
beaucoup à gagner en forces militantes, et en influence, pour changer l’inhumaine
politique menée par les « gouvernants » de la France contre les
arrivants – demandeurs d’asile, migrants, réfugiés : qu’importe comment on
les désigne, ils et elles sont des femmes, des hommes, des enfants.


































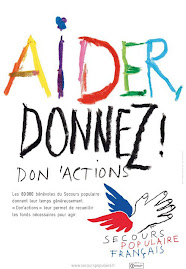




























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire